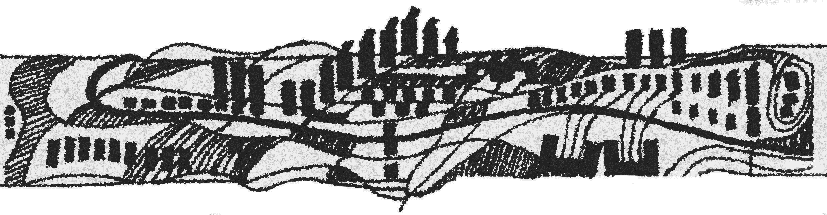Projet d’un pôle universitaire transfrontalier
d’enseignement et de recherche en architecture
13 septembre 2006
Groupe « Genève cinq cents mètres de ville en plus »
Marika Bakonyi-Moeschler biologiste, Philippe Brun architecte, Louis Cornut architecte, Jan Doret architecte, Jean-Noël Du Pasquier économiste, Daniel Marco architecte, Cyrus Mechkat architecte, Rose-Marie Meichtry économiste, Pierre Milleret ingénieur, Raymond Schaffert urbaniste, Nicole Valiquer sociologue
«L’écriture est une forme décadente du dessin parce que tout compte fait c’est de lui qu’elle est née».
Antonio Muñoz Molina in « Fenêtres de Manhattan »
1° Quel architecte pour quelle architecture?
L’architecte dit moderne, exerçant durant les Trente glorieuses (1945-75), et le Miracle helvétique (1937-87) ce que le mouvement moderne en architecture avait instruit pendant le premier tiers du vingtième siècle… et le mouvement artistique pendant le dernier tiers du dix-neuvième… s’était investi, avec parfois la bénédiction et la reconnaissance officielles, pour mettre en forme des opérations d’envergure exprimant, sinon son projet, un grand projet de société : mixité sociale résorbant les conflits de classe, intégration composée de tout ce qui fait la ville : logements, activités, commerces, rues, réseaux de transports, culture, sports, loisirs, santé, places, parcs, etc.
Mais entrant dans le dernier quart du vingtième siècle et après avoir révélé ses limites dès le début des années soixante-dix, le modèle de développement économique et social de l’après deuxième guerre mondiale entra dans une longue crise, qui fit apparaître ses ratés en matière d’aménagement du territoire.
Tout échec mérite son bouc émissaire. Tenu par principe pour seul responsable de ces échecs, l’architecte en vint à souffrir d’un cruel désamour du corps social et politique. Depuis la fin des Trente glorieuses et du Miracle helvétique la figure de l’architecte est en crise. Crise de légitimité sociale autant que culturelle.
La plus évidente preuve de cette crise fut administrée dès 1975 par l’émergence du courant postmoderne. L’architecte dit post-moderne retourna au classicisme et plaqua sur toute construction une esthétique directement pompée du classicisme gréco-romain : le fronton, les colonnades, l’agora et le péristyle à l’ordonnancement symétrique ; tout traitement de l’espace et toute rationalité devaient leur être assujettis.
Fort de vingt-cinq siècles, le classicisme est une référence culturelle du monde occidental – voire au-delà – qui exprime majesté, pouvoir, prestige et pérennité de l’ordre établi.
C’est pourquoi le recours des architectes au classicisme pour (re)mettre en selle leur légitimité est un acte politique récurrent et efficace. Dans ce but ils ont d’ailleurs produit des édifices majeurs que l’on s’empresse toujours de visiter.
C’est déjà ainsi que la figure de l’architecte de la Renaissance avait assujetti les bâtisseurs en les soumettant à des règles de composition pompées dans le De architectura de Vitruve (1ers). Elles rompaient la tradition de transmission orale et pratique de leurs savoir-faire en imposant l’écrit et le plan, grâce à l’appui de leurs princes commanditaires, dont ceux de l’Eglise.
Palais et cités néoclassiques exprimèrent toute la « grandeur » des monarques des dix-septième et dix-huitième siècles : Louis XIV le Grand, Pierre 1er le Grand, Frédéric II le Grand et Catherine II la Grande. L’apogée néoclassique : Napoléon 1er (le Grand, évidemment) en fit le style officiel de l’Empire.
Les premières républiques occidentales ont suivi : combien de palais de justice et autres frontispices de bourses expriment-ils ainsi, jusqu’aux Etats-Unis, la force de nos démocraties ?
Dans l’histoire de l’architecture, le post-modernisme n’est pas la première opération de pompage à cette même source ; mais d’entre elles, c’est la plus abâtardie, populiste et flagorneuse. Alors qu’il s’agit d’une rétrogradation que l’on devrait qualifier de «néo-néoclassique», le vocable «post-moderne» flatte la mentalité dominante, pour qui croit que la chronologie suffit à pousser le progrès en avant. Il vise à attribuer à l’architecte une capacité à bâtir «plus moderne que moderne» comme on lave «plus blanc que blanc».
Lorsque sa légitimité est en crise, l’architecture peut suivre des démarches très diverses, parfois frelatées, souvent opposées. La mode du post-modernisme ayant fait long feu, l’image publique de l’architecte contemporain est surtout dominée aujourd’hui par les principaux acteurs de la bulle financière spéculative mondiale.
Des palaces de Dubaï aux récents gratte-ciels de multinationales en passant par les stades financés par des groupes d’assurances ou des émirats, les architectes du « star-system » s’en donnent à cœur joie. Parfois avec bonheur, fréquemment avec une débauche sans précédent de moyens, de technologies et d’énergies au service de la forme que sacralise sa singularité.
Le gratte-ciel où siège une compagnie pétrolière lui coûte aujourd’hui une à deux semaines de bénéfice net ; le battage de son inauguration et la diffusion mondiale de ses images confortent la cotation en bourse des titres de son propriétaire qui récupère presque aussitôt la mise. Quant à l’architecte, sa glorification lui attire des mandats du même acabit, qu’il mettra autant d’empressement à accepter qu’à faire preuve d’autisme, au cas où son chantier relevait du plus moderne des esclavagismes.
Certes un peu longs, ces développements n’ont d’autre but que de montrer combien l’acte architectural peut être aujourd’hui aussi divers que sujet à caution, combien il est devenu illusoire de croire à la référence d’une figure de l’architecte, à un seul type de formation ou à l’équivalence de ses écoles, et combien il importera d’opérer des choix fondamentaux pour qu’une école d’architecture puisse rendre les services dont la métropole transfrontalière genevoise a particulièrement besoin.
Le premier choix doit être une rupture avec le culte de la singularité, dont souvent les architectes, quels qu’ils soient, sont autant acteurs que victimes. L’image dominante qu’ils ont de leur rôle en reste très imprégnée, l’opinion publique aussi …d’autant que la plupart des concours les y poussent.
De tous les métiers, c’est chez les architectes que règne en maître l’individualisme, revendiqué ou contraint.
Ni les règles professionnelles, ni les associations, ni encore les écoles ne les encouragent ou les préparent à revendiquer d’eux-mêmes un maximum d’ingérences externes de compétences spécifiques au cœur de leur travail, jusqu’aux « savoir cachés » des contremaîtres et ouvriers qualifiés.
Ce que l’on nomme collaboration avec les ingénieurs et les corps d’état est, sous leur autorité, une gestion négociée de droits et devoirs entre domaines respectifs : le droit contractuel des mandats reste d’abord fondé sur la défense de prérogatives.
Le choix de modèles de structures professionnelles, intégrant toutes les compétences de la conception jusqu’à la fin des travaux, est l’exception. La collaboration bornée, au sens propre comme au figuré, est la règle.
En Suisse plus qu’en Europe et à Genève plus qu’en Suisse, les bureaux d’architectes qui comptaient plus de quarante collaborateurs jusqu’à la fin des Trente glorieuses ont fondu ou disparu. L’idéologie individualiste va de pair avec une parcellisation en un nombre impressionnant de petits bureaux dont elle induit l’isolement.
Nombre d’architectes qui y travaillent ont parfaitement conscience des limites de l’individualisme obligé (selon les règles et pratiques actuelles). Ils bossent parfois comme des fous pour un maigre résultat, accumulent des projets qui ne débouchent sur rien, se lancent dans des concours à procédures toujours plus complexes pour se retrouver toujours plus nombreux en concurrence simultanée sur le même objet. Tout ça pour un revenu aléatoire, souvent faible. Quel gaspillage de compétences et d’énergies !
Chapeau à ceux qui, malgré tout, entretiennent consciencieusement une petite flamme de rigueur professionnelle, avec des moyens artisanaux : une école d’architecture métropolitaine pourrait être aussi leur lieu de réflexion, de proposition et de promotion de pratiques professionnelles ouvertes, réoxygénées, moins individualistes, socialement plus efficaces et professionnellement plus gratifiantes.
2° Un projet pour reprendre
Ce projet d’enseignement et de recherche transfrontalier tente de systématiser quelques savoirs, développés depuis plus de trente ans dans une institution aujourd’hui en voie de démantèlement, l’Institut d’architecture de l’Université de Genève (IAUG), aux fins de les reprendre dans une institution universitaire transfrontalière franco-suisse, voire européenne, à créer.
Ce projet renvoie à la figure métaphorique de la reprise, terme familier que l’on retrouve aussi bien dans le travail ménager de la couture, dans la médiation de relations conjugales conflictuelles, que dans l’hypothétique espoir de renouveau économique. Le terme de reprise est emprunté à Soeren Kierkegaard, qui publie en 1843 un roman portant ce titre. Selon l’auteur, la reprise, pour retrouver ce qui a été le même : réinvention, doit procéder d’une manière inédite pour rechercher l’autre : redécouverte. Au théâtre, la reprise d’un rôle ne se réduit nullement à son apprentissage par répétition ; c’est une recréation, une création nouvelle, une nouvelle performance, différente de toutes les autres. Dans le langage des affaires, qui dit reprise ne pense pas récidive, mais nouvel essor. Pour un jardinier, la reprise d’une plante transplantée signifie un nouveau départ dans la vie, comme à chaque printemps lorsque la vie reprend.
Ce projet tente aussi, au paragraphe 7, de proposer dans le domaine de la formation une alternative à un projet territorial transfrontalier national dépassé, qui reste malheureusement une référence didactique immuable.
Ce projet transfrontalier peut être considéré comme évoluant dans la même sphère que le projet territorial transfrontalier urbain du Groupe « Genève cinq cent mètres de ville en plus ».
3° La reprise de la notion de compromis territorial
Tandis que le Temps a depuis longtemps préoccupé les épistémologues des sciences sociales, l’Espace semble rester une place vide dans laquelle les processus sociaux se déroulent, une coquille libre dans laquelle, et dans une relative indifférence, les activités humaines, contenus et contenants, prennent place. Pourtant le problème principal de l’espèce humaine et de son futur semble être aujourd’hui l’espace, son espace et l’usage de cet espace. Tel est le problème écologique; l’écologie urbaine en est l’un des champs les plus importants.
Si les usages qui sont faits des différents facteurs économiques, l’argent, le travail, le sol, peuvent être spécifiques et différenciés, ils ne sauraient être indépendants les uns des autres, reliés qu’ils sont par la contrainte du régime d’accumulation d’un modèle de développement. Les modes de régulation propres à chaque marché : marché des biens mobiliers et immobiliers, de l’argent, etc., même s’ils intègrent les conditions historiques et sociales propres à chacun de ces domaines et observent ainsi des logiques propres, des décalages temporels, ne peuvent entrer en contradiction profonde au risque de compromettre l’équilibre instable de l’ensemble de la formation sociale. On s’attend, par conséquent, à trouver, au-delà des ajustements et tâtonnements locaux, des points de convergence, des logiques parentes, entre la régulation du « travailler », du travail , le rapport salarial et la régulation de l’ « habiter » au sens très large, le rapport territorial. Notons encore une fois que ces convergences n’apparaissent qu’après coup comme telles. Au moment de leur genèse, on observe plus facilement un foisonnement de tentatives sans cohérence, ni liens apparents.
Le rapport salarial ne se définit pas seulement par une problématique interne au domaine du travail, l’usage du travail salarié, mais aussi par une problématique externe qui concerne la reproduction de la force de travail et l’existence des travailleurs qui lui est liée. Cette problématique contient les questions des relations décisives entre le rapport salarial et celui concernant tout ce qui constitue la vie quotidienne : normes de consommation, cultures de l’habiter, etc.
Parmi ces normes et cultures, l’aménagement du territoire, l’urbanisme et l’architecture, ou plus exactement l’inscription sur le territoire des compromis constitutifs du mode de régulation sociale en vigueur, apportent un éclairage essentiel à la caractérisation des formes de cette régulation particulière à chaque pays.
Le rapport territorial est défini par l’ensemble des projets pour le cadre bâti et non-bâti, dans les trois phases de leur socialisation : la conception, la matérialisation et l’utilisation, jusqu’à l’ensemble des règles juridiques institutionnelles qui régissent l’usage du sol. De façon semblable au concept de rapport salarial, il ne s’agit pas de considérer unilatéralement ici les conditions de production du cadre bâti et leurs conséquences sur les structures productives de biens et de services, mais, plus largement les implications de l’usage et des cultures de l’usage, du territoire, à la fois sur les normes de production et celles de distribution/consommation.
Le champ d’action des forces sociales qui définissent le rapport territorial est différent de celui du rapport salarial. Dans le compromis territorial, il n’y a pas, au niveau national, d’équivalent des conventions collectives de travail, ni dialogue collectif permanent direct entre les propriétaires-promoteurs/«producteurs» et les habitants-locataires/ « consommateurs ». Ces relations restent le plus souvent individuelles, locales, voire cantonales et soumises au compromis institutionnel constitué par les lois et règlements. Mais il existe diverses tentatives pour instituer des accords collectifs, en vue de définir de telles relations, comme par exemple celles qui visent à établir en Suisse une « paix du logement » correspondant à la « paix du travail » ou encore celle instituée en 1935 à Zürich entre les défenseurs du patrimoine et les tenants de l’architecture moderne (lire paragraphe n°5).
4° La reprise de la notion de processus territorialisation- déterritorialisation-reterritorialisation et d’une certaine idée du développement durable
Rappelons que sous la pression de marginaux de la francophonie, le Canada et la Suisse, le terme d’origine anglo-saxonne, inventé à Genève, « sustainable development », (développement soutenable) a été internationalement traduit en français par développement durable. A croire qu’il n’y a que les thèses qui soient soutenables et la douleur insoutenable. On a créé une confusion sans pareille si l’on prend en compte que le dit développement durable ne doit rien à la durée.
Processus de territorialisation-déterritorialisation-reterritorialisation
Le texte de ce paragraphe a été écrit par Claude Raffestin et utilisé dans le document de réponse au premier appel d’offre pour la constitution de pôles nationaux de recherche ; une réponse à laquelle participait l’IAUG.
La notion de développement durable telle qu’elle a été lancée par le Rapport Bruntland, en 1987, a diffusé dans toutes les disciplines, donnant souvent lieu à des interprétations dans lesquelles il a été difficile de faire la part de la science et celle de l’idéologie. Sans doute est-ce la caractéristique des nouveautés qui réussissent, celles-ci étant porteuses d’une chose que l’on attendait mais que l’on n’était pas, jusqu’alors, parvenu à identifier. « Our Common Future » est un texte qui appartient à cette catégorie de choses. Force est d’admettre, cependant, que si ce texte est fondamental pour débloquer la réflexion, il est beaucoup plus difficile à utiliser sur le plan opérationnel et c’est pourquoi il convient de la resituer en le réinterprétant dans une perspective capable de nourrir une recherche en matière d’architecture et d’aménagement au travers des sciences tant naturelles qu’humaines.
Tout individu, tout ensemble d’individus, donc toute société, s’organise de manière à rendre possible sa durée propre. La caractéristique commune à tous les organismes et à toutes les organisations est l’idée de continuité. Cette idée est le noyau du développement durable. Pourtant ni l’individu ou la société ne peut durer sans transformation. La continuité d’une société et de ses différentes enveloppes n’est possible qu’à travers des transformations qui se réalisent par de multiples régulations.
Toute société évolue au sens d’une anamorphose. C’est-à-dire que son « image » subit au cours du temps des modifications voire des déformations rendues nécessaires par les adaptations. La société, au plein sens du terme, se transforme et se « déforme » tout en assurant sa continuité à travers le temps : elle n’est jamais tout à fait la même, mais elle continue à assurer ses fonctions dans la durée. Pour y parvenir, elle ajuste et régule ses relations à l’extériorité et à l’altérité. En d’autres termes, sa territorialité, qui est l’ensemble des relations qu’elle entretient avec l’environnement physique (l’espace donné et les territoires produits) et avec l’environnement social (les divers groupes sociaux) pour satisfaire ses besoins à l’aide de médiateurs dans la perspective d’atteindre la plus grande autonomie possible compte tenu des ressources du système, est constamment remaniée.
Le développement durable est donc d’abord une maîtrise de la durée pour assurer la continuité des besoins à travers des relations dont les contenus changent, en raison même de la disparition de certains médiateurs et de l’apparition d’autres médiateurs. Dès lors, les territorialités se succèdent les unes aux autres au cours du temps en se modifiant et en se transformant pour préserver l’autonomie, voire l’augmenter dans la mesure du possible. Il est évident que l’autonomie dont il est question est relative et non pas absolue. L’idée d’autonomie est avec celle de continuité au cœur du développement durable.
Quelques exemples sont nécessaires pour expliciter ces deux idées d’autonomie et de continuité. S’il y a un système de relations à l’environnement physique et à l’environnement social c’est qu’il y a une combinaison d’énergie et d’information qui permet de déclencher ces relations et cette combinaison s’appelle le travail. C’est bien par rapport au travail que l’idée d’anamorphose prend toute sa valeur. Contrairement aux apparences, le travail ne disparaît pas, mais il se transforme d’une manière considérable. Cette transformation remanie le système de relations en créant des ruptures et des discontinuités telles que nous éprouvons tous le sentiment d’une disparition. Il est vrai que des formes de travail disparaissent, mais elles sont remplacées par d’autres. De la même manière, des activités industrielles disparaissent, mais elles sont remplacées par d’autres, des paysages ruraux et urbains se transforment et pour cause puisqu’ils sont la résultante de nouvelles relations dans lesquelles le travail ne joue plus le même rôle.
Le développement durable n’est pas, comme on pourrait le penser à tort, le prolongement d’un passé et d’un présent vers l’avenir mais bien au contraire l’émergence de nouvelles pratiques assurant dans la durée une utilisation continue des ressources disponibles par la mobilisation d’informations crées par les nouvelles formes de travail pour augmenter l’autonomie, c’est-à-dire minimiser les destructions des objets et des sujets avec lesquels on entretient des relations.
Dès lors, le développement durable suppose une connaissance des territorialités passées, donc un recours aux différentes formes d’histoire, une compréhension des territorialités présentes, donc un recours aux analyses propres aux différentes disciplines dans la perspective de restituer des modèles suffisamment synthétiques pour être utiles à la gestion tout à la fois du matériel et de l’immatériel, et une capacité de faire des projets de territorialités futures pour maîtriser les transformations. On se rend compte que tout cela s’inscrit dans plusieurs processus du type territorialisation-déterritorialisation- reterritorialisation (processus TDR) qui sont l’expression même de l’anamorphose et dans lesquels la culture, en tant que mémoire, est mobilisée dans le monde matériel, dans le monde des sensations et dans le monde de l’intellect. Ces trois mondes sont distinguables mais ne sont pas indépendants les uns des autres. Leurs interrelations sont la condition de la connaissance, de la compréhension et de la gestion des territorialités.
5° La reprise d’un compromis culturel fondamental
En Suisse, une manifestation de l’essor de l’enseignement et de la recherche, en matière d’architecture, urbanisme et construction, se situe dans les années trente du siècle précédent.
Ce fait marquant était le résultat d’une conjonction très particulière qui annonçait la future société de concordance helvétique des années soixante. Cette conjonction produisait, en 1935, un accord entre, d’une part, les promoteurs de ce qu’il est convenu d’appeler « le Mouvement moderne en architecture » et, d’autre part, les protecteurs de la nature, des monuments et des sites.
La recherche de nouvelles formes de la ville par les tenants de l’architecture moderne et leur position de transformation radicale du cadre bâti, rendait prévisible un conflit avec le Heimatschutz. Un des enjeux déclarés était la préservation ou la transformation des cités anciennes. Alors que les villes étaient considérées (elles le sont toujours) comme les lieux des pires conditions d’habitat et de travail, se développait parallèlement l’idée que les cités anciennes pouvaient être garantes de valeurs d’identité nationale.
A la suite d’un débat public, les représentants des mouvements progressistes et conservateurs, que tout tendait à opposer, se retrouvaient assis à la même table pour rédiger ensemble une résolution. Résolution publiée dans la revue « Weiterbauen » n°6, de décembre 1936; une revue qui a paru six fois.
Les « Amis du Mouvement pour l’architecture moderne » et la « Société zurichoise de sauvegarde du patrimoine » se sont mis d’accord, à l’issue d’un débat public organisé le 11 décembre 1935 dans les locaux de l’EPFZ, sur les points fondamentaux suivants:
Le Mouvement pour la sauvegarde du patrimoine souhaite ne pas s’occuper de préservation de ce qui est ancien uniquement, mais participer, dans une plus large mesure, au développement vivant de la construction dans le pays.
Les organes de la Société de sauvegarde du patrimoine s’efforcent non seulement de préserver les bâtiments existants et les beautés du paysage, mais d’apporter aussi, par leurs conseils et leurs propositions, un soutien actif aux problématiques actuelles, allant dans le sens d’une reconstitution, conceptualisation organique.
Le Mouvement pour la sauvegarde du patrimoine veut protéger la collectivité des aberrations résultant de l’économie privée et de la spéculation. Dans le futur, il contribuera toujours à permettre l’introduction de conceptions d’urbanisme unifiées et d’un aménagement national, conduit avec systématique, en liens étroits avec la prise de mesures législatives appropriées.
Le Mouvement pour la sauvegarde du patrimoine soutient, de ce fait, le courant des architectes qui, au-delà de tout intérêt privé, apportent leur concours à la composition unifiée de l’image de la ville et du paysage.
Pour pouvoir mener à bien la revitalisation du Mouvement pour la sauvegarde du patrimoine, les tenants du Mouvement pour l’architecture moderne et leurs proches devraient nécessairement prendre une part active au sein de la Société pour la sauvegarde du patrimoine.
A l’avenir, il faudra que les organes de la Société pour la sauvegarde du patrimoine travaillent en étroite collaboration avec les commissions étatiques pour la sauvegarde et que ces commissions attirent également des personnes de la jeune génération.
Dans plusieurs pays d’Europe, il n’en a pas été de même. En France notamment, où depuis ces années-là, jusqu’à aujourd’hui, il existe une forte opposition entre les tenants de l’architecture nouvelle et ceux de l’académisme, adossés aux Beaux-Arts, opposition qui est, sans doute, l’une des origines du relatif isolement de l’enseignement et la recherche en architecture dans ce pays.
L’accord de 1935 a été conclu, à l’origine, dans la sphère d’influence de l’Ecole polytechnique fédérale de Zürich. Alors que ses retombées faiblissent sous l’effet de l’ingénieurisation de l’institution, elles sont reprises et transplantées dans les années soixante-dix à l’Ecole d’architecture de l’Université de Genève. Reprise et transplantation à la faveur d’une autre conjonction entre la ligne de la Tendenza tessinoise et celle des critiques radicaux des Beaux-Arts, qui deviennent désormais les deux lignes de la nouvelle direction de l’EAUG. L’institution genevoise est, dans les années quatre-vingt-dix, une des premières en Europe à organiser une formation post-grade en «Sauvegarde du patrimoine bâti moderne et contemporain».
6° La reprise du principe de l’extension de la sauvegarde du patrimoine bâti à l’ordinaire de la ville et le retour de l’expertise dans le projet
A cette tradition culturelle s’ajoute, en s’y mélangeant, au début des années quatre-vingt, un bouleversement radical dans les projets pour les villes qui favorise grandement la mise en place de la formation post-grade traitée au paragraphe précédent.
Le modèle de développement dominant après la deuxième guerre mondiale en matière de formes et de contenu de la croissance des villes procédait selon deux aspects solidaires :
Intra-muros, se déroulait un processus intensif de changement du cadre bâti par démolition-reconstruction ou transformation lourde de l’existant.
Extra-muros, progressait une dynamique extensive. Un nouveau cadre bâti s’implantait sur les terrains ruraux, villes nouvelles, cité-satellites, grands-ensembles, etc.
Intra-muros, ce phénomène opérait aussi sur la pérennité des cadres bâtis ; il les assujettissait à son rythme. Dans le modèle, il n’y avait aucune raison économique de conserver un bâtiment ordinaire si le terrain sur lequel il était édifié dépassait sa valeur.
L’entrée en crise du modèle de développement met fin au phénomène urbain qui lui était attaché et, par là-même, aux relations étroites entre ses deux aspects principaux. Désormais, démolitions-reconstructions et transformations lourdes intra-muros ainsi que croissances urbaines extra-muros vont s’atténuer relativement, du moins se diluer sur l’ensemble du territoire urbanisé.
Pour tenter de répondre à la situation de crise généralisée, un nouveau projet pour les villes apparaît et se développe à la fin des années soixante-dix : la remise en état des cadres bâtis existants. Depuis cette période et jusqu’à aujourd’hui, cette nouvelle orientation de projet est devenue la source principale des activités du secteur de la construction.
Les budgets des collectivités publiques, eux aussi touchés par la crise, diminuaient fortement et, parallèlement, diminuait l’ampleur du phénomène urbain dominant les années soixante, facteur de dépenses considérables.
Disposant de moins de ressources, les collectivités publiques entreprenaient alors de mener des politiques d’amélioration de l’habitat et des cadres bâtis existants de la fin du dix-neuvième siècle, du début du vingtième et récents des années soixante. Le principe de sauvegarde du patrimoine bâti était étendu à tout l’ordinaire de la ville.
Pendant la période où le phénomène urbain à double action agissait, l’expertise se séparait du procès de travail de l’architecte. Cette séparation était due au fait que l’expertise devenait relativement extérieure au projet. Elle ne visait plus qu’à estimer le prix d’un cadre bâti qu’il s’agissait de démolir.
Avec l’extension du principe de sauvegarde du patrimoine bâti, l’expertise redevient complète, réintègre le procès de travail de l’architecture et récupère la trilogie : diagnostic, nature des travaux de remise en état et coûts. Le cadre bâti existant est une partie intégrante du projet. Son expertise ne peut pas en être séparée.
La mise en place en 1998 d’une formation post-grade intitulée « Expertise immobilière » par l’IAUG en collaboration avec le Département d’Architecture de l’EPFL et l’Université de Fribourg, est l’une des concrétisations de ce retour D’autre part, tous les nouveaux instruments, les nouveaux métiers, toutes les nouvelles formations liées à ce retour de l’expertise dans le projet et au développement du projet de « reprise » des cadres bâtis existants ont opéré une jonction avec les instruments, métiers et formations de la « tradition » issue de l’accord de 1935 ; une jonction qui a fourni une forte assise « constructive » à la formation post-grade dont il est question au paragraphe 5.
C’est dans le cours de cette mise en commun, dans les années quatre-vingt, qu’à l’EAUG puis à l’IAUG, dans le cadre d’une recherche menée pour l’Office Fédéral du Logement (OFL), ont été développées les MER, Méthodes d’Evaluation Rapide des dégradations, des désordres et des manques et d’évaluation rapide des coûts de remise en état des bâtiments d’habitation.
Ces méthodes MER qui permettent de mesurer l’ampleur des détériorations et des lacunes et de calculer les coûts de remise en état avec une précision suffisante, ont été inventées au moment de la récession qui frappe l’Europe dans la fin de l’année soixante-dix en Angleterre puis en France. Dans ce pays c’est l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH) qui dirigea la recherche et la publication sur les MER.
7° La reprise de la critique de la «décentralisation concentrée»
Depuis les années trente du siècle passé, les politiques d’aménagement du territoire tentent, avec plus ou moins de succès (plutôt moins!) et de conviction (plutôt plus!), d’appliquer les principes fondateurs d’égalité et de solidarité confédérales, principes perpétuellement battus en brèche par une polarisation continue, incessante, des activités dans les grands centres urbains.
Ces principes, dits de base, sont toujours remis sur l’ouvrage, car si la majorité des Suisses habitent des centres urbains, ces derniers font encore peur et il est toujours d’actualité de déclarer que les Suisses n’aiment pas leurs villes. Depuis trois-quarts de siècle, les autorités tentent, à contre-courant, d’imposer un compromis territorial qu’elles veulent solidaire et égalitaire, mais qui, aussitôt mis en place, commence à se déliter.
Il y a soixante-dix ans, Armin Meili, l’un des protagonistes des débuts de l’aménagement du territoire en Suisse, élabore le concept de « Weit Dezentralisierte Grosstadt Schweiz » (Grande ville suisse largement décentralisée). Après la Seconde Guerre mondiale, en 1949, Hans Carol et Max Werner reprennent les thèses de Meili dans « Städte wie wir sie wünschen » (Les villes comme nous les voulons). Cette idée de décentralisation concentrée va subsister jusqu’à aujourd’hui.
En effet, l’Office fédéral du développement territorial, (ODT) dans son Rapport 2005 sur le développement territorial, examine quatre scénarios. Le premier est tendanciel : une Suisse des métropoles ; le deuxième est tourné vers le déclin urbain par dispersion et éclatement, le troisième dessine un réseau de villes, une Suisse urbaine polycentriste et le dernier préconise une solidarité territoriale, une Suisse des régions. Puis l’ODT en tente la synthèse : cinq aires métropolitaines – Zürich, Bâle, Berne avec Bienne et Fribourg, Genève et Lausanne, Lugano – entourent autant d’agglomérations. Chaque aire possède une ville-centre sauf, curieusement, Genève-Lausanne, où il y en a deux. Ces aires correspondent via un réseau stratégique de villes appelées agglomérations-centres Neuchâtel, Bienne, Olten, Aarau, etc. Le projet est complété par un essaim de centres touristiques et de centres ruraux. Mais est-il vraiment utile de réaffirmer sans cesse une position ultra défensive et volontariste ? La question est d’autant plus justifiée après la longue crise des années quatre-vingt dix et au vu du nouveau modèle de développement économique et social qui se met en place. La propension à négocier ne caractérise pas les dirigeants économiques et la recherche de la proximité des grands centres de décisions et de communications tient lieu de principe d’aménagement du territoire.
Face à la tendance à la polarisation - contenus et contenants - des populations et des entreprises autour des grandes villes du pays ne faudrait-il pas privilégier une politique territoriale qui tienne mieux compte de la réalité et vise à en limiter les effets les plus en contradiction avec les principes que l’on dit (et écrit) vouloir défendre ? Par exemple en projetant une hiérarchie du territoire et des villes avec leurs régions, y compris, Europe oblige, les interfaces transfrontalières. Ce serait sans doute plus efficace en matière de développement durable que devoir reculer sans cesse et sans l’avouer devant la progression de la tendance.
Mais pour réorienter drastiquement la politique de la Confédération helvétique en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire vers un tel objectif, il s’agit aussi de modifier fondamentalement la formation des urbanistes et des aménagistes. En effet, dans ce pays, depuis soixante-dix ans, les principales institutions responsables de l’enseignement et de la recherche dans ces domaines forment des étudiants et mènent des recherches dans un leurre, pire dans un appât idéologique, mélangeant égalité et solidarité confédérale avec une critique simpliste de la ville. Ce qui brouille toute approche du territoire en termes de projet. Formation et recherche mettent en avant une approche de la ville, de la grande ville, considérée, d’une part, comme prédatrice d’espace et lieu de perdition morale et, d’autre part, comme grande malade au chevet de laquelle il faut tenir un rôle de guérisseur. On est très loin de la devise «Stadt Luft macht frei» ! Cette position postule qu’un projet territorial national qui prendrait comme base la réalité, afin d’en gommer les effets les plus pervers et, pour ce faire, établirait une hiérarchie entre les grandes, les moyennes et les petites villes, ne saurait être qu’un projet repoussoir. Un projet dont la diabolisation ne sert que les intérêts d’un acharnement politique historique à vouloir retarder une échéance incontournable.
8° La reprise du projet d’architecture
Sous le terme projet d’architecture il est entendu le projet dans toutes les activités de l’architecte: du design au projet territorial.
Le projet
Le projet d’architecture considéré comme le traitement en alternance de lieux. Lieux que Thomas Maldonaldo a défini sous les titres: microambientale: intérieur de la maison (micro espace), mésoambientale: quartier, voisinage (espace média) et macroambientale: ville, région (macro espace). Définitions elles aussi reprises et prolongées à l’EAUG puis l’IAUG sous les titres: cellule, agrégation et tissu, ou: logement, mode de groupement et distribution des logements, tissu urbain.
Le projet n’est plus une approche de type rationaliste qui consiste au traitement projectuel continu des passages d’une grande échelle à une plus petite, par des stades intermédiaires relativement immuables et invariables, et qui se justifie par l’antienne taylorienne selon laquelle la qualité du tout est la somme de la qualité des parties (cf. ici les différentes échelles).
Développée depuis les années soixante-dix, l’approche du projet en tant qu’unité s’est concrétisée dans les différents aspects suivants :
Le projet d’architecture en tant que projet de la forme du cadre bâti dans la maîtrise des relations formes-activités.
Le projet d’architecture en tant qu’intervention pour modifier un cadre bâti créé par l’histoire et qui utilise celle-ci comme instrument.
Le projet d’architecture autant comme procès que produit : « la traversée est aussi importante que le port ». Le projet pose notamment dans cette approche les questions des relations entre projet et usagers.
Le projet d’architecture en tant que niveau de conception le plus élevé du « rapport territorial », du « compromis territorial », ainsi que du procès de « territorialisation-déterritorialisation-reterritorialisation ».
Le projet d’architecture en tant que partie décisive dans le développement soutenable, par exemple par la prise en compte des écosystèmes urbains et ruraux.
Le projet d’architecture en tant qu’outil spécifique qui permet de construire les problèmes, de mettre en évidence les questions. Le projet n’est pas un outil qui vient à la suite de la découverte et du recensement de besoins qui doivent êtres traduits dans l’espace.
Le projet d’architecture en tant que procès et produit interculturel.
Le contreprojet
A partir de ces principes s’est aussi développé particulièrement pendant la période de l’Ecole d’architecture, une culture du contre-projet d’architecture à propos par exemple du plan d’aménagement du quartier des Grottes, du plan localisé de quartier (PLQ) de l’ilôt 13 dans le même périmètre ou encore du PLQ du triangle de Villereuse aux limites des quartiers des Eaux-Vives et de Champel.
Un contreprojet d’architecture n’est pas une variante. C’est certes une critique qui vise une situation donnée ou trouvée mais c’est aussi un projet qui doit pouvoir exister de manière autonome.
Un contreprojet d’architecture met en question le procès de la production courante du projet d’architecture.
Un contreprojet d’architecture change ses propriétés inventives par la résistance à une situation forcée, par l’opposition à une imposition.
Un contreprojet d’architecture n’a pas comme finalité immédiate sa réalisation. Il sert aussi à comprendre et à transformer une situation.
Un contreprojet d’architecture est souvent conçu à partir d’un modèle qui recèle les données fondamentales. Il a les caractères apparents d’un type. Une marque qui constitue sa force de critique et de démonstration.
Un contreprojet d’architecture existe souvent en parallèle à une contestation sociale d’un projet officiel. Il est fréquemment provoqué par le mouvement social et culturel qui engendre cette contestation mais il reste relativement indépendant de celui-ci. En effet les rythmes et les échéances du mouvement social ne correspondent que très rarement aux temps du contreprojet.
Les nouveaux territoires du projet
L’aménagement du territoire et le développement durable c’est en premier lieu le devoir de mettre les territoires à leur bonne échelle de lisibilité, de partenariat et de projet.
Les problèmes posés ont pris une telle ampleur qu’il n’est possible de leur fournir des solutions que s’ils sont correctement identifiés et étudiés en termes de contenu et d’organisation à une échelle adéquate qui leur appartient et trace, le plus souvent, de nouveaux territoires de projet.
Aujourd’hui on assiste à l’émergence de ces territoires de projet qui peu à peu prennent la suprématie sur les anciens territoires institutionnels.
Le projet dans la ville
Le caractère spécifique de la forme de la ville a été très bien défini par Charles Baudelaire « La forme d’une ville change plus vite hélas que le cœur des mortels ».
La spécificité du projet urbain est qu’il mobilise un territoire donné dans un temps déterminé et qu’il est ainsi unique, non-reproductible et en constante transformation, soumis aux actions conjuguées des hommes et de la nature.
Comment dans un tel projet, dans une situation en mouvement, choisir, créer, utiliser, mettre en place, développer des persistances et des permanences territoriales urbaines? Une question qui en cache ou plutôt qui en désigne une autre: Avec qui choisir et créer des constantes de forme et de contenu? Sans participation, concept ancien devenu classique, pas de projet; sans projet, pas de participation. Voilà les questions auxquelles il s’agit de répondre.
Il s’agit d’établir et de motiver des règles qui concourent à la création de projets pour la ville en tant que parties prenantes à un processus de formation d’un compromis territorial. Des projets que doivent permettre la mobilisation d’une aire donnée du territoire, dans un temps donné, pour un objectif donné. Une mobilisation qui doit rassembler les représentants des autorités locales et des forces sociales en présence dans la ville.
Ces règles exprimées par des dessins et écrits prenant la forme de cartes et figures ainsi que de recommandations et prescriptions seront fondées sur des méthodes mettant en œuvre des idées et principes clairement définis qui se réfèrent à la territorialité humaine et au développement durable.
Il s’agit ainsi de construire des instruments afin de répondre aux questions posées par les conditions d’existence des habitants dans les villes, questions qui peuvent se regrouper en quatre grandes catégories :
• Migration et territoire: la ville, forme et appartenance. La ville en tant que lieu d’asile ou de rejet des immigrants, des réfugiés, etc.
• Travail et territoire: la ville, forme et production. La ville en tant que lieu des mutations du travail : chômage, travail précaire, etc.
• Exclusion et territoire: la ville, forme et usage. La ville en tant que lieu d’exclusion ou d’intégration des catégories sociales précaires, sans-domicile-fixe, working-poor, etc.
• Santé et territoire: la ville, forme et santé publique. La ville en tant que lieu pathogène ou sain et sûr pour les populations urbaines fragilisées.
La croissance des métropoles urbaines et les problèmes que cette croissance génère nécessitent de nouvelles compétences dans le projet pour la ville et le territoire. La construction d’un projet pour Genève métropole transfrontalière a nécessairement besoin d’un lieu de fabrique d’idées et d’échanges intellectuels, qui devra offrir une formation en urbanisme réellement interdisciplinaire, s’inscrivant dans un réseau régional et interrégional.
La conceptualisation d’une telle politique demande aussi un lieu de forum, un espace de discussion pouvant réunir universitaires, scientifiques, responsables politiques et culturels. Dans la mission dévolue aux formations d’architecture et d’urbanisme, il y a, au-delà de l’enseignement et de la recherche, l’impératif de s’adresser à toutes les personnes concernées, mais aussi de réfléchir et reformuler les questionnements à celles-ci.
9° La mise en valeur des trésors cachés du secteur de la construction
Il faut rappeler que, pendant la période de la domination du modèle de développement économique et social précédent, avant la crise des années quatre-vingt/quatre-vingt-dix, modèle qu’il est convenu d’appeler fordiste, période des Trente glorieuses française, 1945-1975, et des cinquante ans du Miracle helvétique, 1937-1987, certaines activités, certains métiers, ont mieux résisté que d’autres à l’application, souvent à marche forcée, à leurs procès de travail des principes issus de la théorie organisationnelle des entreprises de Frédéric Winslow Taylor.
C’est le cas du secteur d’activité de la construction. Contrairement aux thèses qui le considèrent comme un secteur archaïque, en retard sur les industries manufacturières de série, la construction doit être considérée comme un secteur original suivant un mode spécifique de développement.
Développement qui tient à la spécificité de son procès de production. Le travail a un rôle essentiel dans l’efficacité économique du secteur.
Les profonds changements qui interviennent à la faveur de la montée des commandes liées aux activités de reprises des cadres bâtis. Entretien-maintenance-réhabilitation-modernisation, projets dans et pour l’existant, rappellent avec force ces caractéristiques. Ils mettent aussi en évidence les contradictions qui apparaissent entre ces spécificités et les modes d’organisation et de gestion du travail et de production souvent parachutés depuis les industries manufacturières de série.
Le secteur de la construction peut être décrit par quatre caractéristiques:
• La variabilité externe et interne du procès de travail. Non seulement le produit de la construction est généralement différent d’une région à l’autre et d’un usage social à l’autre, mais les techniques utilisées pour la réalisation d’un même produit peuvent varier d’une entreprise à une autre, ou à l’intérieur d’une même entreprise, voire d’un chantier à un autre. Cette double variabilité limite très fortement les possibilités de mise en œuvre de tâches parcellisées et répétitives soumises à la contrainte du temps.
• L’impossibilité d’appliquer les règles de l’équilibre propres aux industries manufacturières de série provoquée par cette diversité de techniques. La recherche d’un optimum en matière de temps d’occupation des équipements, des postes de travail et des équipes de salariés ne peut pas être conçue à partir de règles précises et stables.
• L’inexistence dans ce secteur de machine-outil ou de dispositifs similaires. Il n’existe pas de temps de travail calculés par la «machine» qui s’imposent. Pas de temps qui puisse servir de mesure à l’organisation du travail. L’utilisation d’outils et non de machines-outils comme dans les industries manufacturières de série ne facilite pas le contrôle du travail.
• Dans le procès de travail de type chantier, les tâches élémentaires d’opération sont intrinsèquement liées aux tâches de régulation. Alors que dans les industries manufacturières de série ces différents types de tâches ont pu être dissociés et répartis dans des corps de salariés différents : les ouvriers spécialisés, les ouvriers professionnels, etc., dans le secteur de la construction une telle division du travail n’a pas pu être réalisée. Qu’il s’agisse de réduire les « surtemps » de travail : retouches, temps de coordination, temps de réaction aux aléas, temps morts, etc., les « surconsommations » : défauts de qualité, retouches, pertes ou vols, importance des stocks, etc., les interfaces entre les hommes de différents niveaux de compétence et de responsabilité sont au centre des procès de travail et de production. La principale difficulté des entreprises du secteur réside ainsi dans la façon dont est maîtrisée la gestion des interfaces et sont assumées les tâches de régulation. La mise en place et l’engagement d’un procès aussi sophistiqué soit-il de parcellisation et de contrôle strict des tâches directement productives passe aujourd’hui, dans le secteur de la construction, à côté de l’essentiel et nuit à une bonne gestion des tâches de régulation de leur efficacité. Ainsi, alors que dans les industries manufacturières de série le contenu de la productivité porte sur « l’intensité directe du travail », dans le secteur de la construction elle porte sur « l’intensité connexe du travail ».
La construction a ainsi occupé une position décisive dans le régime d’accumulation intensive et comme secteur non-fordien, dans la crise des années quatre-vingts/quatre-vingts-dix. Elle occupe par l’intermédiaire de sa branche immobilière une même place-clé dans le nouveau modèle de développement, dit du capital financier, qui se met en place depuis.
Le déphasage relatif de la construction par rapport à la taylorisation généralisée a permis à des savoirs et des savoir-faire d’être prolongés et non pas intégrés dans des machines. Le secteur est devenu et resté ainsi une «machino-facture».
Le recensement, le développement de ces savoir-faire, la mise en valeur de ce qui peut être qualifié de trésor caché, doivent être des objectifs principaux de tous les partenaires économiques et sociaux du secteur patronat, syndicats, propriétaires/promoteurs immobiliers, locataires. Une mise en valeur liée à l’amélioration constante de la qualité des produits du secteur et qui passe notamment par la pérennité d’institutions d’enseignement et de recherche.
10° Pourquoi un pôle universitaire transfrontalier d’enseignement et de recherche en architecture à Genève
La relation entre lieu et formation
Il s’agit enfin de remettre en question une conception que la grande majorité des institutions de formation supérieure et post-grade ont de leur rôle, conception qui postule que l’on peut traiter n’importe quel domaine dans n’importe quel lieu. A ce niveau de la finalité du système de formation existe une territorialisation très relative des activités d’enseignement et de recherche.
L’étude de la dégradation des barrières de corail en relation avec le réchauffement du climat de la planète n’est sans doute pas un sujet à traiter dans les montagnes de Suisse de même la question de la concentration urbaine des trafiquants et consommateur de drogue (par exemple le Letten à Zurich il y a quelques années) n’est pas traitable dans un chef-lieu campagnard (Appenzell par exemple)…comme d’ailleurs le traitement de l’ordinaire de la ville dans un village de pêcheurs.
Les domaines d’enseignement et de recherche de l’ex-EAUG et de l’ex-lAUG, dont il est question dans ce texte et qu’il s’agit selon nous de reprendre, doivent beaucoup au lieu et à l’histoire ancienne et récente de Genève, métropole transfrontalière de plus de 750'000 habitants, où ils ont été inventés et développés.
Genève c’est aujourd’hui 718’659 habitants dont 413’673 (57%) à Genève, 166’799 (23%) dans le Genevois français de Haute-Savoie, 71’218 (11%) dans le Genevois français de l’Ain et 61’974 (9%) à Nyon.
C’est à l’échelle des métropoles que se situent aujourd’hui les grands enjeux de l’aménagement du territoire. L’urbain déborde largement les frontières institutionnelles : communales, cantonales, nationales, etc. en les annulant peu à peu. La maîtrise, et les projets qui lui sont liés, de cette évolution quasi inéluctable passent par de nouvelles formes de collaboration, d’organisation et de nouvelles transversalités. Dans ce cadre, l’espace transfrontalier franco-valdo-genevois constitue un terrain particulièrement bien adapté au projet et à la recherche en aménagement du territoire.
Situation
Un rapide examen des institutions en présence montre bien les très bonnes conditions existant autour de la métropole genevoise pour mener à bien ce projet.
La Confédération helvétique
Les quatre scénarios du Rapport 2005 de l’ODT ont déjà été présentés et critiqués dans le paragraphe 7. Il manque dans ce rapport un cinquième scénario, celui capable de maîtriser l’échéance incontournable constituée par la très forte polarisation: le scénario des différences.
L’Etat français
Il faut relever:
Le changement de cap de la DATAR, Délégation à l’aménagement du territoire et l’action régionale, qui devient la Délégation interministérielle à l’aménagement et à la compétitivité des territoires DIACT. La politique d’aménagement du territoire français s’infléchit vers l’organisation et le développement de l’attractivité et de la compétitivité des territoires plutôt que vers la création et le développement de pôles d’équilibre comme c’était le cas jusqu’à aujourd’hui.
L’expertise française qui, comparant les villes européennes, montre qu’en dehors de Paris, ville mondiale à soutenir et développer encore et encore, aucune autre ville française n’émerge sur la scène urbaine de l’Europe et conclut au soutien prioritaire à celles qui peuvent progresser : Lyon ; et à la mobilisation de tous les atouts et opportunités en la matière : Genève.
Le soutien du gouvernement français à Genève d’abord, qu’il considère comme «la première place des négociations internationales située dans le monde francophone» et à qui il attribue son appellation de métropole.
La région Rhône-Alpes
La région Rhône-Alpes est en pleine phase d’extension. Elle (re)cherche ses appartenances, ses atouts et stratégies. Elle est une région française singulière : «une deuxième chance pour le France».
C’est une vaste région constituée par huit départements, l’Ain, l’Ardèche, la Drôme, l’Isère, la Loire, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie, disposant d’un réseau de plusieurs villes ; Annecy, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Grenoble, Lyon, Saint-Etienne et Valence, qui participent à trois grands territoires visibles, le nouveau sillon alpin (l’espace alpin), la vallée du Rhône (le grand sud-est) et la métropole de Lyon.
Chacune des villes du réseau urbain rhône-alpin, notamment Annecy, Chambéry, Grenoble et Lyon, a une vision d’accroche de ce réseau avec la ville de Genève et des idées diverses de partenariat avec celle-ci.
Pour l’ordinaire de la ville
La formation d’architecte dont la métropole de Genève a besoin doit s’articuler sur la connaissance, la maîtrise et le développement de l’ordinaire de la ville. Elle doit surtout rompre avec la culture individualiste qui imprègne le métier, faisant de la singularité du projet la voie privilégiée vers le succès professionnel et la reconnaissance publique. D’autres écoles d’architecture fondent leur enseignement sur l’idéologie du « star system », de manière sous-jacente ou explicite : laissons-les, ce n’est pas notre projet. Alors, puisse l’existence de telles écoles n’être jamais invoquée pour contrer le pôle universitaire transfrontalier d’enseignement et de recherche en architecture, un projet nécessaire, en criant au « doublon » !
Le paysage et ses données climatiques, la morphologie urbaine et son histoire, la sauvegarde du patrimoine, la physique du bâtiment, la statique, l’ergonomie, la gestion écologique des ressources énergétiques et des matériaux, la sociologie, etc., toutes ces branches doivent faire de cet ordinaire de la ville la colonne vertébrale d’une rationalité maîtrisée, argumentée et scientifique, pour mieux en contenir l’épine dorsale (l’architecture comme acte culturel) et la moelle épinière (l’émotion esthétique comme aboutissement et non comme but premier).